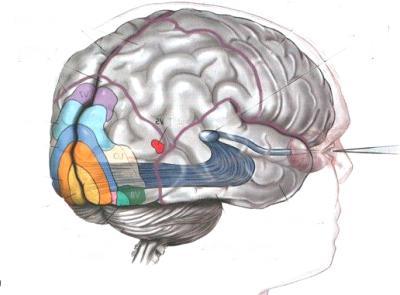Il suffit de regarder nos photos de famille pour se rendre compte que ce que nous avons été n’est plus. Notre corps d’enfant a disparu pour laisser la place à un corps d’adulte. Pourtant, nous avons la conscience de la permanence de notre être malgré ces changements de formes.
L’expression de Lavoisier, célèbre savant du XVIIIème siècle, “ Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ”, tendrait à montrer que l’angoisse que nous procure l’idée de la mort est intimement liée à une notion illusoire de perte. Ainsi, la mort faisant naturellement partie de la vie, avoir peur de mourir peut entraîner un refus de vivre. Arnaud Desjardins, ex-réalisateur de télévision, soutient cette thèse dans son ouvrage “ L’audace de vivre ”. Il écrit : Oser vivre, c’est oser mourir à chaque instant mais c’est également oser naître…
Ce que nous apprend le mythe
À en croire Otto Rank, psychanalyste autrichien du siècle dernier, auteur du livre » Le traumatisme de la naissance » , nous sommes tous marqués par cet événement originel, nommé aussi angoisse de dissociation. Le sentiment de perte est déjà inscrit en nous à ce moment-là, alors que la réalité nous montre que nous n’avons absolument rien perdu. Au contraire, nous avons gagné en indépendance. De fait, si nous abordions la mort dans cette perspective d’individuation, peut-être la faucheuse perdrait-elle son aspect terrifiant… D’ailleurs, dans la mythologie grecque, Thanatos, personnification de la mort, est fille de la nuit et sœur du sommeil. Comme sa mère, elle a la faculté de régénérer. Ambivalente, elle est liée à la symbolique de la terre. Il ne faut donc pas y voir seulement le côté négatif, même si c’est l’une de ses réalités. Mais plutôt considérer son aspect évolutif. Les psychologues, en accord avec le mythe, savent qu’en tout être humain une tension existe entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. La mort n’est donc pas envisagée par ceux-ci comme une fin en soi mais comme la condition même de l’évolution des choses.
Une résistance au changement
Mors janua vitae, dit la locution latine : La mort porte la vie. D’ailleurs, que de progrès avons-nous faits en abandonnant une situation qui n’avait plus de sens : une conduite addictive, une liaison conflictuelle, un travail aliénant, etc… Sophie raconte : Il y a très longtemps que je savais que ma dépendance à la cigarette n’était pas bonne. Pourtant je m’accrochais à elle, ayant l’impression d’être incapable de vivre sans. Jusqu’au jour où j’ai compris, avec l’aide d’un thérapeute, que le tabac m’empêchait de me réaliser pleinement dans ma passion, la musique. En fait, le symptôme cachait ma résistance à abandonner mon métier d’enseignante, un métier sécurisant où le salaire était assuré mais qui n’était fait que de compromis. La pratique de mon instrument, la clarinette, demandait une qualité de souffle que je ne m’autorisais pas à avoir en fumant. À partir de là, j’ai accepté de faire le deuil d’une cigarette par semaine, puis deux, et ainsi de suite… Jusqu’à ne plus fumer. Parallèlement, j’ai rencontré Clément, chef d’orchestre, qui m’a assurée de mes compétences artistiques et proposé une place dans sa formation, à condition de reprendre mes études musicales là où je les avais laissées. Aujourd’hui, je suis en passe d’abandonner mon métier pour vivre ma passion. Autant vous dire que la cigarette a complètement disparu de ma vie…
Sentiment de manque et sage questionnement
Ce n’est pas notre propre mort qui nous angoisse mais plutôt le sentiment de vide. Nous souffrons de la perte d’un être cher parce qu’il nous manque, qu’il nous rappelle que nous aussi sommes mortels et qu’il faudra un jour quitter tout ce à quoi nous sommes attachés. Cela va de notre compte en banque jusqu’à notre corps physique ! La notion de temps est ici très importante. Nous avons une vie entière pour expérimenter ce manque en tant qu’il peut être dépassé. C’est tout le sens du travail de deuil qui permet toujours de passer à autre chose. Or, notre société a tendance à occulter ce temps. Aujourd’hui, il faut aller très vite. On meurt plutôt à l’hôpital, le corps est rapidement écarté de la vue, il n’y a parfois pas de veillée mortuaire. Sous prétexte de modernité, la mode est à la crémation, nous coupant de nos racines culturelles et même aussi de lieux symboliques dédiés aux défunts. La confusion mort/vie peut s’installer encore lorsque les cendres du grand-père trônent au-dessus de la cheminée… Quant à savoir si la mort est une illusion ou une réalité, il n’y a pas de réponse toute faite dans la mesure où personne n’a refait le chemin inverse… Si ce n’est le Christ, à la différence près que ses disciples ne l’ont pas reconnu tout de suite. Ce qui tendrait à prouver qu’une transformation s’est quand même effectuée. Mais nous rentrerions ici dans le domaine de la croyance qui relève de l’intimité de chacun. En revanche, tant que nous sommes vivants, il s’agit de ne pas se laisser invalider par la peur de la mort : La peur de la mort est une illusion, affirme encore Arnaud Desjardins, ne vous troublez pas avec la peur de la mort. Ce qui est vraiment important, c’est de vous libérer de la peur de vivre ! S’interroger sur les obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement est donc essentiel. D’autant que nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour mourir à nos angoisses existentielles afin d’accueillir le mystère du devenir de la vie. Pour cela, il suffit juste de pousser un peu la porte de nos certitudes…
Gérard Guny